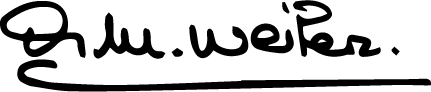Quelques images de ma vie

Extrait du blog écrit pour Jacky Scala en 2007 ?… A compléter et corriger …
Un soir de mai, en rentrant chez moi, j’ai trouvé un message particulier sur mon répondeur. C’était une voix lointaine…Lointaine dans le temps, 35, 40 ans ? Lointaine dans l’espace, puisqu’elle venait du midi…Pourtant, je l’ai reconnue tout de suite, le timbre, la couleur, la ligne mélodique, le phrasé qui me parlaient de mes vingt ans… Denise ! – Denise SCALA ! C’était comme tirer sur le fil de mes souvenirs, instantanément tout s’est mis à défiler…
Et qui dit Denise, dit Jacky – Les Scala !
LA SCALA !!!
Bien sùr, j’ai rappelé tout de suite, et ce fut comme si on ne s’était jamais quittés ! J’ai ressenti une telle joie ! En un instant, j’ai retrouvé la politesse exquise, la délicatesse de ces amis, et tout fut simple, comme ce qui vient du coeur. Jacky m’a parlé de son projet, du blog, et je me suis mise à écrire, avec l’envie de retrouver ceux qui restent, de les revoir, pas comme des anciens combattants, mais comme des frères et soeurs avec lesquels nous avons partagé tant de choses, sans bien comprendre encore…
Parmi eux, j’ai d’abord pensé à Jenny avec une infinie tendresse et je me suis demandée comment on pouvait quitter, oublier, les gens qu’on aime ? En fait, la vie nous emporte ailleurs, on ne les quitte pas, on ne les oublie pas, ils sont juste là, derrière un arbre, dans le jardin, on fait quelques pas et on les retrouve… J’espère revoir Jenny, à l’origine de ma rencontre avec la Scala, ce qui n’est pas rien ! Nous nous étions connues en vacances, Jenny et moi, en juillet 1967, à Divonne -les -Bains, à la frontière suisse où nos mères faisaient une cure. Les mères sont devenues amies, les filles aussi ! Dans une boîte de nuit, nous avions rencontré Guy Béart, à l’époque il était très connu, un chanteur engagé à succès, et pas encore et surtout le père d’Emmanuelle; Jenny l’a connu de plus près que moi. De retour à Paris mon amie m’a emmenée à la Scala et présenté » la famille ».
Située au bas de la rue Lacépède et presqu’en face du jardin des plantes, « la boutique » avait une devanture en bois, avec une porte à carreaux en verre dépoli, que rien ne distinguait. Pas de ripolin, de couleurs tapageuses ou d’enseigne lumineuse: le carrefour était discret, il fallait connaître et on y venait par parrainage. Affinités électives et raisons majeures : rencontrer les autres, tous ces talents confondus, venant des quatre coins de Paris, de la banlieue, de la province et même de l’étranger.
Jacky, maître des lieux, accueillait son monde avec une égale bonne humeur. Et le quartier était une pépinière d’artistes, car, en grimpant quelques centaines de mètres, on arrivait à la Contrescarpe. Lieu mythique, s’il en est avec » Le Cheval d’Or » , associé à Anne Sylveste, et autres cabarets où se sont essayé moult chanteurs devenus célèbres, le célèbre luthier Etienne Vathelot, et tous les restaurant minuscules de la rue Mouffetard où l’on mangeait du poisson grillé, des girolles et des myrtilles en hiver, et d’énormes steacks sur des planches avec des pommes de terre inondées de crème fraîche, très « in » et nouveau à l’époque !
De l’autre côté, c’était Saint-Michel, Saint-Germain, pas très loin, toute la rive gauche, « le Bateau ivre », « La vieille Grille », sans parler de l’Isle Saint-Louis, Notre Dame, et du square à ses pieds, territoire des » verlandeux » qui y faisaient leurs frasques : nous étions au coeur de Paris. C’était l’époque « Peace and Love », les tenues hippies… « Hippie hippie, hippie, hippie…pi ! », chanté par Michel Delpech, et je déambulais en pantalon de velours patte d’éléphant, mauve moiré, longue tunique, gilet indien recouvert de petits miroirs, colliers à breloques grosses comme des noix, large ceinture sur les hanches, cheveux enturbannés de soie – hyppie de luxe !:… On se parfumait au Patchouli, odeur très particulière qui me rappelait le baigneur en celluloïd de mes six ans, et que je retrouve aujourd’hui dans les bâtons d’encens. On écoutait les Beatles, Donovan, Léonard COHEN, Joan Baez, Maurice DULAC et Marianne MILLE, rencontrés plus tard, Marianne pour laquelle j’avais fabriqué un gilet coloré à sequins d’or pour son passage à l’Olympia. Style latino. Période Machu Cambos,… C’était l’époque sans sida, sans « no tabac », sans pollution encore, la liberté des corps… Et puis Bach, Vivaldi, la Traviata, pourquoi pas?
La Scala ouvrait vers vingt et une heures et Jacky finissait quelquefois son dîner sur le bar quand je poussais la porte. Je me souviens avoir souvent vu Denise ou Sylvie, jolie rousse, leur fille aînée, descendre ou remonter son assiette. Denise était parfois accompagnée de Sophie, leur deuxième fille, bout de chou avec une grosse frange et de grands yeux marrons qui observaient avec acuité. Son visage était amusant, ouvert, comme sa nature de petite fille gaie et drôle, tandis que Sylvie, cheveux Botticelli, semblait plus mélancolique et davantage dans l’univers secret d’une Fée Irlandaise.
Jacky servait en salle, mais quand la soirée était étale, il quittait son comptoir et s’asseyait à nos tables en prenant sa guitare, jouait aux échecs ou discutait avec nous. Denise qui travaillait le matin de bonne heure, et avait charge d’âmes à l’étage, descendait en début de soirée, et c’était un plaisir de partager son équilibre et sa sagesse de femme. Elle me faisait du bien, était à la fois une amie, une grande soeur dont j’ appréciais la maturité et l’ancrage. L’endroit n’était pas grand, mais rempli d’esprit et Jacky jamais débordé, quelles que soient les entrées : ça coulait Méditerranée… Avec lui, planait l’accent de la garrigue, du pistou et du serpolet qui donnaient à Paris le soleil du midi où il est reparti…
Denise et Jacky n’étaient pas des gens d’argent, mais ils avaient une générosité évidente qu’ils impulsaient au lieu. Pas de ces envies de posséder des biens ou un pouvoir, ils roulaient dans une voiture bleu marine sans âge, une Simca, je crois, et ils s’en moquaient. De la même manière, les gens qui fréquentaient la Scala, avaient une passion, une discipline, ou bien ils étaient amoureux, ce qui pouvait être un état, mais on n’entendait pas parler d’argent, de quête d’argent. Il y avait une autre manière d’être et la politesse, peut être, de laisser l’obsession au vestiaire. En tous les cas, cela ne sous-tendait pas les rapports. Les relations ne s’établissaient pas pour un intérêt financier quelconque, mais grâce au partage d’affinités, aux passions, et chacun était reçu.
Jenny m’avait dit : » Tu verras, c’est particulier, un lieu très intéressant ! » – Coup de foudre à vie ! En fait, je réalise maintenant que ce fut la porte ouverte sur une nouvelle existence. J’avais vingt et un ans, calibrée par une éducation bourgeoise un peu corsetée, je commençais à sortir du cadre, ou pour tout dire : j’explosais ! Nous étions en septembre 67…Neuf mois plus tard, le temps d’une gestation, c’était mai 68… De la Scala, nous entendions la « petite guerre », le remuement des pavés, nous sentions la fumée, allions de temps en temps jeter un oeil, et recevrions les commentaires d’étudiants qui venaient se récupérer après une castagne avec les CRS. De ma banlieue m’arrivaient seulement les voix ébahies des reporters en scooter, sur les ondes d’Europe 1 ou R T L, décrivant les premières flambées : la Scala était un fauteuil d’orchestre sur l’événement !
Mais l’endroit fut surtout pour moi, une école et une clef des champs. Contradiction apparente, ce fut le contexte où j’ai pris conscience de ma vraie nature, sans la nommer encore : j’étais une artiste et rien d’autre ne m’intéresserait jamais ! Ainsi, il existait une nouvelle manière de vivre, de penser, qui permettait d’être différent, accepté et de sortir du moule qu’on me proposait !!! – La graine était semée !
La Scala était à la fois un café, un théâtre, un lieu de rencontre et de paroles, où foisonnait un brassage de cultures exaltant. Etudiants, comédiens, chanteurs, concertistes ou peintres bohèmes, chacun pouvait lire son poème, le texte de sa chanson, prendre une guitare ou pousser la voix – des pires comme des meilleures, et je n’ai pas peur de le dire : j’ai fait partie des pires –« Et pourtant elle tourne ! »
– la terre ! Chanson sur Galilée, commise par Jacky, toujours souriant et patient, accompagnant ma voix de crécelle et celle des choeurs à la guitare ! – Nous avions l’ambition de faire un groupe !… Waouh, waouaaah !… J’ai même passé les auditions de « Hair » avec Bertrand Castelli, autant qu’il m’en souvienne, et l’ai gratifié de la chanson de Marie Madeleine : » Dites-moi comment faire re… pour l’aimer, pour lui plaire … re !! … » Suivant !… My God, quel trac !
Mais la Scala c’était, avant tout une famille, un lieu d’amitié qui devait tout aux Scala, pour leur qualité d’hospitalité, leur non jugement et leur capacité à fédérer : des humanistes ! Grâce à eux, ce monde bariolé se côtoyait sans histoires, et je n’ai aucun souvenir d’événements désagréables, choquants ou blessants, d’ une risque, ou même d’un fleuret moucheté verbal acide, car si on riait beaucoup à la Scala, on savait aussi s’y tenir ! … Il y avait les gens de passage, les occasionnels et les quotidiens, les habitués dont je faisais partie, car un jour sans Scala était pour moi impensable. Préambule à tout, on s’y retrouvait pour la soirée et faire la fermeture le plus souvent, ou juste pour prendre un verre. Deux heures de transit, puis on allait dîner, au cinéma, voir d’autres amis, mais une soirée sans un passage était une soirée où il manquait quelque chose. A la Scala, je plantais mes repères, bétonnais ma solitude, partageais ma jeunesse et mes idées avec ceux de ma race. Les libres penseurs, les artistes, les anars, les poètes, les plumes au vent ou dans le derrière, les « gratouilleurs », les verbeux, les ventres vides ou les souffrants, les enfants de dieu et ses canards sauvages… Faune universelle et superbe !
Parmi les habitués, il y avait Rodolphe KARSENTY, et je n’ai jamais su qui il était, ni ce qu’il faisait dans la vie, nous n’étions pas curieux de ça. Pour moi, Rodolphe était un titi, un soldat de l’armée américaine dans « Paris brûle-t-il ? » un fou de cinéma qui connaissait par coeur les dialogues de classiques en noir et blanc. Je l’entends encore imiter Arletty dans « les enfants du Paradis ». Carné 43. Garance: « Le jour on se dispute, mais la nuit, au lit on se comprend ! » Il manque un morceau de la citation : je l’ai oublié, mais lui, savait. Et puis, Brasseur, Frédéric Lemaître, et Arletty, encore, dans « Hôtel du Nord », avec : « Atmosphère, atmosphère, est ce que j’ai une gueule d’atmosphère ? » tant entendu, rabâché, usé, élimé, comme dans le non moins célèbre « Quai des brumes » avec son : « T’as de beaux yeux, tu sais ! » qui, comme Arletty a fait le tour du monde. Je l’ai entendu en plein désert tunisien. Un bédouin écoutait une radio française sur un petit poste branché sur la batterie de son moteur. Le capot du camion était levé, et la voix d’Arlety sortait de là ! – Insolite! … J’ai repensé à Rodolphe cette nuit là dans l’oasis, sous les palmiers…
Bernard LAVILLIERS chanta ses premières chansons à la Scala, et « fréquenta » Jenny et Nelly, mes deux amies, pas ensemble, mais l’une après l’autre ! Baroudeur, déjà branché sur le Brésil, nous avions, Nelly et moi, porté son premier disque « Polydor » à Victor Azaria, à la Maison de la Radio, pour qu’il passe sur les ondes…
Nelly LEWIN, habituée de la Scala, travaillait à la télévision. Grâce à elle, j’ai participé à un film avec Pierre Richard – » Perrault 70″ . La Scala conduisait à tout !
Je me souviens aussi d’une pièce de Clara MALRAUX : » L’impermanence » jouée par Catherine ARDITI que je revois de dos avec ses longs cheveux, scandant de ses mains nerveuses, le flanc d’un flipper…Elle a gardé ses dents du bonheur. Son frère, Pierre, était venu à la première – pardessus Camel, visage plus rond, cheveux plus courts, discret et neutre, pas encore le ARDITI charismatique que nous connaissons : en tous les cas, pas ce soir-là, mais c’était la soirée de sa soeur à la Scala !
Dans les habitués, il y avait encore Francis MOZE, l’indien, catogan et cheveux déjà poivre et sel, grand garçon fort et large, qui ne pouvait nier ses origines. Fils d’un indien d’Amérique du nord, venu faire la guerre en Europe et d’une française, Francis était un sensuel qui adorait manger, entre autre du maïs et cuisiner exotique : il faisait ça très bien en plein milieu de la nuit ! Compositeur, guitariste, il fut l’un des musiciens à l’origine du groupe « Magma » et jouait au « Gibus Club », près de la République.
Henri DES, le chanteur pour enfants, fit de nombreux passages à la Scala, et nous avons fait connaissance un soir où il était venu prendre un verre après un concert. Pas encore l’Olympia, mais je l’ai raccompagné ce soir-là du côté de Stalingrad et il m’a parlé de sa femme, de l’enfant qu’elle venait de mettre au monde, du fait qu’il l’avait assistée et participé à l’accouchement : c’était le début des pères responsables, touchant et magnifique !… Je me souviens d’une certaine feuille de platane ramassée en marchant sur les quais, et je le revois, jouant avec dans la voiture avant qu’on ne se quitte…J’ai gardé un souvenir chaleureux et tendre d’ Henri DES. Je suis heureuse de son succès.
Caroline CELLIER, ravissante comédienne, encore peu connue, plus tard épouse de Poiret venait aussi de temps en temps, prendre un verre, tout comme Gérard LENORMAND … Le petit Prince était somptueux, immense, plus d’un mètre quatre vingt dix, de longs cheveux bouclés, c’était l’archétype du Prince charmant… et, en plus, il parlait aux oiseaux !
A côté de la Scala, il y avait « l’Inca », tenu par Pâris ZURINI, un voisin aux cheveux blancs et courbé par les ans. Toujours vert, l’Italien Pâris avait fait un enfant à une jeune femme, brunette dodue à l’aspect campagnard, une Aline Charigaud pour son Renoir !… D’un premier mariage, Pâris avait deux fils : Manou, grand, costaud, photographe, coureur automobile et accessoirement séducteur, qui faisait partie, avec » Béru » de la » bande à BELTOISE. «
La bande était composée de fous du volant, l’automobile à la mode, et l’époque sans complexe : on se prenait tous pour Graham Hill ! On se rendait sur les circuits, au Mans, à Monthléry, et le dimanche matin certains prenaient des cours de conduite à Magnicourt sur des formules France pour apprendre à négocier les virages : Savoir prendre la corde, ne jamais freiner pour ne pas perdre l’adhérence, surfer sur les routes en dévers, traiter les épingles à cheveux ! Nos voitures étaient gonflées, équipées de sièges baquets, de jantes larges, de gros phares à iode, et décorées de bandes blanches et de numéros sur les portes. Les pots d’échappements étaient remplacés par des pots Abarthe qui faisaient beaucoup de bruit – exprès !!!… Les décibels ne comptaient pas, la pollution non plus : Brague ! Brague ! Brague ! (prononcer gue comme gueuse ! ) nous faisions vrombir les moteurs avec le trois pédales, double débrayage à la mode, participions à des courses de côtes, nous entraînant sur les lieux la veille, pour aller plus vite, toujours vite, le chrono dans la main du coéquipier, puis reprenant le volant chacun notre tour, passionnés par nos performances, et je n’étais pas la dernière ! – C’était la bande des Gordini !
Un jour, Manou avait emprunté ma voiture, et la ramenant l’avait garée dans un tête à queue spectaculaire devant la Scala. Sur le trottoir, des amis et quelques passants sidérés avaient admiré l’artiste qui avait frôlé les voitures stationnées dans cette rue étroite, passant à deux ou trois centimètres des carrosseries sans faire aucune égratignure . De la haute voltige ! J’en transpire encore !
Manou est parait-il devenu un grand sculpteur et vit aux Etats-Unis … dixit Jacky !
Et puis, il y avait Gabi, son frère cadet, musicien, long et mince, sensible et fin, qui avait fabriqué lui même son clavecin. Il me le confia, pour le mettre à l’abri, chez mes parents, le temps d’un déménagement…
Je me souviens aussi de Bernard, le marin breton, blond navigateur aux yeux bleus et aux cheveux bouclés, qui sillonnait le globe et nous faisait rêver sur un requin ou une raie manta, qu’il avait caressée sous le ventre… Bernard est auréolé de bleu turquoise, de soleil sur la mer et du chant des sirènes…
Et puis un jour, Christian Marcantetti, le marseillais débarqua à la Scala avec sa guitare pour conquérir Paris. Sûr de lui, ne doutant de rien, avec toute la force de ses vingt ans, Rastignac du vieux port avé l’accent rauque qui déchire, Christian chantait et voulait faire carrière… Il exaltait, sur trois accords, son amour pour Christelle, dans un texte sans concurrence pour Brel, sublimant cette fiancée du moment, restée au pays et qu’il cocufiait allègrement: « Christelle, mon amour, ma belle… » avec la voix la plus fausse du monde ! Christian nous a beaucoup fait rire, j’avais trouvé pire que moi !… Christian qui me disait; « Ta robe, elle est pas rose, avé la bouche en cul de poule, ta robe, elle est rase, t’ enteng : RASE ! Vous ne savez pas parler, à Paris, peuchère ! »
Et puis, j’ai rencontré Jacques Godreuil, un joli nom qu’on n’utilisait jamais. A la Scala, ses copains l’appelaient » Béru « , sauf moi, qui n’avais pas lu « San Antonio ». Par extension, sa mère fut affublée du prénom » Félicie » , mère de Bérurier, je ne me souviens même plus d’avoir connu son vrai prénom !?… Petite bonne femme nerveuse et sèche, Félicie travaillait à la clinique Geoffroy Saint Hilaire, juste en face la Scala. Le soir, je dînais quelques fois chez elle et elle me préparait une salade avec des oignons blancs… Je me souviens que nous mangions ça le jour où un homme a marché sur la lune !… Dans nos assiettes : la salade romaine, les ronds d’oignons, et la sauce vinaigrée de Félicie, et sur l’écran : Amstrong descendant de sa capsule et sautant sur une autre planète ! Nous étions sortis sur le balcon pour regarder la lune … – de loin !… Les hommes venaient d’égaler Tintin !
Jacques, lui, travaillait dans une imprimerie et en rentrant venait prendre un verre à la Scala, la porte en face chez lui. A l’époque, j’avais une jolie Fiat coupée de demoiselle, celle qu’avait si bien garée Manou, une petite nerveuse, au moteur qui chauffe et m’avait fondu quelques joints de culasse sur les routes d ‘Italie. Nous étions plusieurs à avoir des envies de voir mer au coeur de l’hiver, et il avait été décidé que nous partirions explorer les côtes de la Manche un week-end… Ce qui fut dit, fut fait… La bande partit en Normandie invitée par Jacques dont les grand-parents avaient une maison dans le Cotentin… Restaurants, promenades à pieds sur les plages, novembre était frileux sur la Manche, mais certains se sont baignés, fous à lier. Zabu et Ezra que nous regardions derrière la vitre du café, emmitouflés et bien au chaud, sortaient en fumant de l’eau glacée, vainqueurs mais violacés !…Admiration, chocolat chaud, ils n’ont rien attrapé… Courses de Gordini sur les petites routes côtières, nous sillonnions la zone du débarquement. Un matin ma voiture se mit à chauffer au pays des caramels, et rendit l’âme à l’entrée d’Isigny… J’ai dû la laisser dans un garage et la réparation fut longue… Je repartis avec Jacques plusieurs semaines de suite : la Fiat : ça crée des liens !
Dans les années 80 je travaillais dans une agence de pub, et derrière la fenêtre de mon bureau, en bas, sur le trottoir, j’ai revu Jacques fumant toujours sa gauloise, au coin de l’avenue de Friedland et de la rue Arsène Houssaye. Je n’ai pas osé descendre ni lui faire signe par la fenêtre et il ne m’a pas vue. Plus tard, c’est lui qui m’a rappelée, il avait trouvé mon numéro et m’a parlé de sa vie. Il avait épousé une femme médecin, avait des jumelles, et habitait boulevard de Grenelle … Il semblait heureux, c’était bien !
Zabu et Ezra étaient de brillants étudiants, des musiciens, et Zabu était aussi chanteur, il avait une voix incroyable, rauque, magnifique, que j’ai reconnu sur la bande annonce d’un feuilleton télé… Voix remplacée, depuis par Herbert Léonard. Et puis Ezra, son ami, son alter égo qu’il ne quittait jamais. Ezra, aux cheveux frisés, aux petites lunettes caractéristiques, ovales, comme celles de Napoléon III – Des cerveaux, ces deux là ! Zabu était mince, de petite taille, habillé de kaki, un précurseur du pantalon bi -place, avec l’entre jambe à mi-cuisse. Ses cheveux étaient noirs, longs et raides, et il les balançait souvent d’un coup de tête en arrière, ou, lassé, les attachait en catogan. Mais, surtout, il avait cette voix unique, éraillée, sensuelle, déchirée et déchirante, ce timbre grave et si particulier qui aurait pu faire carrière. Je lui en parlais souvent : « Qu’est-ce que tu attends, va voir une maison de disque, fait des maquettes ! « , mais cela ne semblait pas l’intéresser, en tous les cas, pas à n’importe quel prix. J’en déduis, qu’ il ne voulait pas se faire dévorer par le star système ! Zabu était un être libre, voulait le rester et garder son âme : il avait sûrement raison, mais nous avons perdu quelque chose !

Alain, le tombeur !
Dans les figures notoires qui ont fréquenté la Scala, bien avant moi, il y avait Alain Heiss, qui fut de toutes les périodes, de toutes les aventures, jusqu’à ce qu’il parte aux Etats Unis. Grand, blond aux yeux bleus, de type américain, avec sa coupe G.I, un long corps musclé, mais travaillé sans excès, Alain ressemblait à Mike Marchal, le fils de Michèle Morgan. C’était un fort beau garçon et il en profitait ! Peintre de son état, c’était, surtout, le tombeur de ces dames, et d’autres copains, bien moins lotis, lui faisaient une pub ou contre pub, selon le point de vue d’où l’on se place, en lui érigeant une statue de Don Juan ou de Casanova, qui n’a pas mieux fini…
Des anecdotes couraient à son sujet, racontant qu’il passait d’un lit à l’autre dans la même nuit, et que certaines filles énamourées dormaient sur son paillasson, en attendant son retour. Alain, qui peignait sur la place du Tertre, y vendant plus ou moins bien ses Poulbots, eut envie de changer d’air et partir pour l’Amérique. Il vécut deux ans à New York et, en rentrant, me fit comprendre que rien ne valait les françaises… A ses dires, les femmes américaines, trop matérialistes comptabilisaient tout, donnant des tickets de rendez vous aux plus offrants dans les boîtes de nuit. Qui pour un dîner, un cadeau, ou une sortie offerte !… Notre Don Juan dépité n’avait pas sa place chez les « Amerlos » et décrivait, dans l’intimité d’une Scala à l’échelle humaine, des boîtes de nuit sur plusieurs étages, gigantesques, comme des lieux brassant des milliers de personnes qui ne communiquaient pas… Pas sûr que cela se soit arrangé !… Ecrans obligent !… Au milieu de tout ça, dans une solitude extrême, Alain avait préféré rentrer en France où il avait ses repères. A la Scala, il était en famille : Don Juan était un sensible qui se l’avouait enfin !
Et puis, il a changé d’activité, devenu photographe, je lui dois de merveilleuses séries de photos, à Paris comme à Deauville ou Honfleur… « Miroir, mon beau miroir… » – La Top Modèle mania avait déjà frappé !
Alain m’a rappelée en 91, nous avons dîné sur Paris et, par la suite, nous nous sommes parlés de temps en temps, au téléphone. Il était parti s’installer dans le midi, pas très loin de Denise et Jacky, justement – au pays des melons, pas loin du Pont d’Avignon… Il y a ouvert un restaurant en souvenir de la Scala, d’Arletty et de Rodolphe, restaurant qu’ il a appelé : « La belle époque ! » . Un accident de voiture a occasionné une rupture dans sa vie, des troubles du comportement l’ont perturbé quelques années, et puis, Jacky m’a appris qu’il avait fait le grand voyage vers la Lumière… L’ange blond avait définitivement quitté la terre..
Parmi les fidèles présent tous les soirs, il y avait encore un étudiant brillant, un garçon brun, à lunettes, et à la voix traînante, amoureux fou de France Gall : Michel Puterflamme, dit : Hagaï !… Je ne l’ai jamais appelé autrement que Hagaï et la sonorité de ces deux syllabes, ( phonétiquement Ragaï ) quand je l’entends sonnailler dans ma mémoire, s’accompagne du rire de son propriétaire, curieuse impression ! Je le raccompagnais souvent rue de Clignancourt, à l’heure de plus de métro. Nous parlions longtemps dans la voiture et il me faisait rire, avec cette voix nasillarde si caractéristique qui était la sienne. C’est étonnant, comme on se souvient des voix… La sienne était un rien paresseuse, lambinante, tirant sa flemme comme au sortir du rêve, alors que c’était un garçon qui bossait tout le temps… Hagaï s’était, un jour acheté un solex, heureux de la liberté que ça lui procurait, je le revois sur l’engin ronronnant, se penchant exagérément dans les courbes, virevoltant devant la fontaine de la rue du Sentier, faisant le clown à l ‘entrée du Jardin des Plantes… Peu de temps après, nous avons appris sa mort. Choc ! Toute la Scala fut en deuil. Hagaï s’était fait projeter vers le ciel avec son solex, au dessus de la rue Clignancourt, en entrant un soir… Un soir, comme ceux que nous avions souvent partagés, un soir ordinaire, aussi banal que ceux où il descendait de ma voiture en souriant et me disant : A demain !… La mort, à vingt ans, on ne s’y fait pas…
Hagaï riant à dents écartées, dents pleines du bonheur à venir, en solex, sur un ciel étoilé, avec un violon sous le bras, c’est ainsi qu’il me plait de le garder – la poésie surréaliste d’un Chagal lui va bien…
A quelques pas de la Scala, dans un immeuble en pierre de taille, au dernier étage d’une tourelle, habitait un comédien qui eut lui aussi son heure de gloire. L’ un des tout premiers à avoir serré Brigitte Bardot dans ses bras au cinéma, Jean François Calvé fut aussi le héros d’ un feuilleton en noir et blanc dont j’ai oublié le nom… On se croisait sur le trottoir près de la Scala quand il promenait son chien… Silence, on tourne… Une personne de sa famille m’a appelée il y a environ quatre ans pour m’apprendre son départ, encore un qui avait pris le train pour les étoiles !
Pour finir, je voudrais parler de Vitold !… Je l’ai gardé pour la fin, comme le meilleur, et le plus atypique !… La plus belle leçon de vie !
Vitold était un habitué qu’ on voyait quasiment tous les jours, joueur d’échec invétéré, il avait toujours une partie à faire. On ne savait pas lui donner d’âge. Intemporel, inclassable, c’ était une personnalité unique, mais avant tout, c ‘était un homme courtois, silencieux, discret, jamais vulgaire ni blessant, souriant toujours, et qu’ à aucun moment je n’ai entendu se plaindre. Pratiquant les échecs de l’ouverture à la fermeture à deux heures du matin, il avait un bon niveau et ne manquait pas de partenaires. Habillé de la même manière été comme hiver, il paraissait élégant dans son pardessus de lainage noir et blanc, aussi élimé que la chemise qu’il recouvrait, et dont le col était toujours fermé par un noeud papillon. Il portait un chapeau à l’année et quand il l’enlevait, c’est à dire pratiquement jamais, on découvrait un crâne dégarni, rose et un peu jaune, avec des tavelures barrées de quelques cheveux qui avaient dû être blonds.
D’origine polonaise, Vitold aurait pu faire partie de ces Russes blancs émigrés à la chute du Tsar, un Prince en exil, un Vicomte en maraude ou un Barine bien né, mais de cela il ne parlait pas. Quand il livrait des bribes de sa vie d’avant, il nous bluffait avec l’aisance de celui qui aurait appartenu à une cour princière, et décrivait son présent de la même manière, évoquant le faste de ses salons, son mobilier raffiné, la vaisselle dans laquelle il mangeait, citant les innombrables marques de whisky ou de Champagne qu’il offrait à ses convives, là encore rien de vulgaire, d’ostentatoire, de déplacé, rien d’un parvenu : il parlait comme un Prince, avec classe, forçait le respect, et même si l’ on percevait quelque chose de décalé, de mystérieux à l’arrière plan qui nous intriguait, rien n’était jamais vraiment dit ou su et personne ne se posait de questions… C’était Vitold et c’était bien comme ça.
Pourtant, discrètement, l’indigence pointait. Notre ami portait la barbe, une énorme verrue sur la joue et il lui manquait des dents, mais le trou était comblé la plupart du temps par un fume cigarette en bakélite noire prolongé d’une cigarette anglaise qu’il glissait avec élégance et minutie à l’intérieur et sans jamais enlever ses gants. Vitold portait toujours des gants, souvent blancs ou prétendus tels, en cuir l’hiver, en mailles l’été, gants que comme le chapeau, le pardessus, le fume cigarette et le noeud papillon il ne quittait jamais. La tête penchée sur l’échiquier, totalement à ce qu’il faisait, il ne levait les yeux sur la salle qu’entre deux parties. L’oeil était pétillant et bienveillant : il regardait nos âmes…
Vitold, on l’aura compris, était un mystère pour tout le monde et des bruits couraient… Quelqu’un disait l’avoir vu au petit matin à Montmartre, poussant un landau au pied du Sacré-Coeur. Cette nuit-là, il n’était pas habillé dans la tenue que nous lui connaissions, celle immuable du manteau de laine noir et blanc, mais vêtu d’un jean, d’une marinière rayée bleu marine, et portait une casquette et des bottes de caoutchouc qui remplaçaient les souliers de cuir beige. Le fume cigarette avait laissé la place à une pipe, et il s’apparentait-là davantage à Popey qu’ à un Prince Polonais, les épinards en moins.
Ainsi, Vitold était clochard, et c’était son secret. Quand il parlait de l’apparat de sa maison, on entendait pétiller le Champagne dans les flûtes en cristal, la lumière des candélabres se reflétait dans les miroirs de la Galerie des Glaces, et les soirées étaient éblouissantes, uniques, planétaires : on valsait dans les palais de Saint – Petersbourg – robes à crinolines somptueuses, les hommes portaient des vareuses à brandebourgs brodées d’or : nous étions chez Tolstoï ! … Vitold nous invitait souvent à venir prendre un verre dans ses appartements, mais nous éludions, mettions une distance, reportions l’instant. Et puis, un soir, de guerre lasse, par curiosité, politesse, quelqu’un a accepté et rendez-vous fut pris pour le lendemain soir.
Notre ami nous conduisit sur la Montagne Sainte-Geneviève devant un immeuble en démolition à côté du « Coupe Choux « , un restaurant réputé, très à la mode. La destruction du bâtiment avait été interrompue par les Beaux-Arts pour cause d’escalier classé, et autres vestiges du XVII ème, et s’il resta longtemps dans cet état de ruine, il eut cependant et contre toute attente un locataire pour le moins insolite !
Le chantier était entouré de palissades recouvertes d’affiches, et nous cherchions une entrée, sourcils levés, ébahis, sidérés, quand Vitold tira sur un panneau et nous livra le passage. Il souriait avec malice et nous précéda : » Je rêve, pince-moi ! « me dit mon voisin
tandis qu’ on foulait les gravas… Vitold remis le panneau en place et ajouta goguenard : « Suivez le guide, je vous mène à la grande entrée ! « , tandis qu’il nous précédait au pied de l’immeuble éventré. Seuls les murs porteurs étaient encore debout sur deux étages, et la grande entrée était un dédale de montées et descentes autour d’un escalier effondré et de couloirs. Nous avons dû nous glisser sous des poutres, des marches au bois pourri, du ciment fracturé, et ramper par endroit pour arriver à » l’appartement « … Ca n’était pas le chemin le plus court, nous l’avons su après, mais Vitold avait voulu pour nous des sensations fortes ! En entrant, une salle assez grande faisait apparemment fonction de chambre et de salon, ancienne boucherie dont il restait les frigos qui lui servaient d’armoire, Vitold ouvrit une porte : » La garde robe de sa Seigneurie ! » . Une montagne de fripes remplissait l’armoire à viande, de toutes tailles, toutes couleurs, tous folklores, costumes de scène, boléros à paillettes, smokings, longues robes à strass, bottes, chaussures, il aurait pu faire de la location pour le théâtre …
Flanquée de chaises et fauteuils à la tapisserie râpée, la seconde armoire était remplie de vieux disques vinyle, bibelots, revues et autre bazar et Vitold annonça : » Fauteuils Louis XV, manufacture des Gobelins d’origine, motifs furies, bergère cérusée, vaisselle Cluny ! « ,
et il alluma des chandelles éclairant notre chemin au rythme de sa marche, et découvrant pour nous le plus improbable palais !
Un invraisemblable bric – à- brac jonchait le sol sur une épaisseur d’au moins cinquante centimètres, composé de couches de papiers, journaux, cartons, et chiffons superposés, feuilletage instable sur lequel on avait du mal à marcher, et qui nous faisait perdre l’équilibre. J’ai compris plus tard que cette moquette particulière devait l’isoler du froid l’hiver, car bien sûr, il n’y avait pas de chauffage, pas d’eau, pas d’électricité ni aucune forme de confort. Des bibelots accumulés dans tous les coins dégoulinaient de meubles aussi instables que le sol, image d’une civilisation achevée sur une terre dévastée. J’avais pensé à la planète des singes, quand on découvre les vestiges de la statue de la Liberté enfouie dans le sable… Le cataclysme était ici adoucit par les bougies sur les chandeliers d’argent. Les pampilles en cristal se balançaient à peine sur la débine, imperceptiblement, et sous le souffle léger de nos voix comme ces sons que l’on perçoit sur la rive d’un lac, quand le vent les porte d’une rive à l’autre, cotonneux, irréels et pourtant là, comme nous à cet instant dans cet incroyable lieu. Les pampilles sous les bougies nous sauvaient de ce capharnaüm lui donnant par leur éclat irisé et dansant des allures de Versailles ! La misère en était ouatée et presque glorieuse, dotée de féerie, et l’endroit semblait une sorte de sas s’ouvrant sur un plan inconnu entre ciel et terre… Conte inouï fourbissant l’imaginaire, séquence colorisée d’un film de Cocteau où l’on traverse les miroirs, nous partagions fascinés l’invraisemblable, l’unique, le savourant dans sa totalité, car nous portions habits, perruques poudrées, jabots de dentelle et bas blancs, canne à pommeau d’argent, et étions conviés à souper dans la chambre du Roi !
Contre les murs s’allongeaient de grands cartons et une étagère en verre contenant un nombre invraisemblable de bouteilles d’alcool quasiment vides qui faisaient la fierté de notre hôte qui lui ne buvait pas. Il citait les grandes marques, ses amis étaient le « Tout Paris », la « Jet Set » influente, des « People » qui venaient, disait-il, dans ce gourbi innommable comme la chose la plus évidente du monde… Il était si simple, si princier, qu’il avait presque fini par nous convaincre, et nous aimions nous embarquer dans ses chimères comme une réponse à sa bonté. Le voyage était joli, grandiose et notre artisan d’artifices nous tenait en haleine : » meuble Boule, tapisserie au dessin de feuille d’acanthe, que puis-je vous offrir ? » , son accent slave avait sonné en désignant l’étagère aux whisky… Cette nuit-là Vitold nous donna des verres dépareillés et si sales que seuls, l’amitié, un moral à toutes épreuves et les tranchées de Verdun pouvaient les rendre licites. Il nous servit ensuite un liquide jaune tout droit sorti de ses poubelles nocturnes, whisky qui avait dû voyager dans le landau, mais que chacun but comme sur une scène de théâtre, comme des enfants faisant semblant, une dînette où l’on échangeait des sourires convenus, mais avec la conscience d’accomplir un acte sacré qui confinait au partage eucharistique ! … Vitold versait en souriant l’huile de la veuve !
Le petit matin s’annonçait, nos bâillements devenaient frileux, il était temps de prendre congé !… Nous nous étions levés, quand notre hôte proposa : » Avant de partir, je vous conduis sur ma terrasse, vous allez voir ma salle de bains et mon solarium ! Suivez le guide ! » Après une nouvelle crapahute dans les poutres et les gravas, nous avons grimpé quelques restes de marches et sommes arrivés sur une plate forme à ciel ouvert. Vitold pointa un arrosoir suspendu à une poutrelle : » Ma douche ! « et pour toute démonstration tira sur une ficelle qui bascula l’ arrosoir . Le plus extraordinaire est qu’il semblait heureux, parfaitement heureux ou avait la politesse de nous le faire croire. Heureux de ce rien qu’il possédait en creux, comblé dans cette vie marginale et rude, mais pourtant intégrée puisqu’il nous fréquentait, partageait nos nuits et nos rires, nos cigarettes et nos échecs, et nous offrait de temps en temps un café comme s’il s’était agi d’un grand cru classé ! Mais, surtout, il se donnait lui, sans le savoir, comme la plus formidable leçon de vie au monde… Pudeur, humour, Vitold restera une énigme et c’est sa poésie. Un être surréaliste, mythomane ?… Il serait vulgaire de chercher à savoir, de vouloir répondre aux questions, on ne touche pas au silence du coeur. Seigneur dans la débine, tendre et généreux avec un mot gentil pour chacun : je pense à lui avec une infinie tendresse : il restera pour toujours mon Prince Clochard, un être libre et qui avait compris l’essentiel …
Photos et texte en vrac, désordre relatif, souvenirs approximatifs… Mille choses pourraient encore se dire, je pourrais ajouter que tout ça se déroulait sur fond de guerre du Vietnam, de bonzes en flammes, de Printemps de Prague, Yann Pallach, l’étudiant, tragédies et bonheurs d’un monde en marche, Woodstock, Beatles, Stone, Barbara et puis, et puis : le printemps de Vivaldi … Et le téléphone de Paris, où les numéros racontaient encore quelque chose, téléphone à en tête, qui indiquait le quartier… OPEra 12 14, MONmartre 36 40, PASsy 11 25… Retrouver des gens aimés au bout du fil ?… Livre aux voix du passé, versé sur du papier…
S’il existait un endroit similaire dans Paris, je serais curieuse d’aller y voir. Mais non, finalement, car la Scala était unique et correspondait à une époque : la nôtre, je ne me retrouverais sûrement pas dans cette nouveauté… Denise et Jacky furent des passeurs, je leur suis infiniment reconnaissante d’avoir permis cela…
Mille bisous à ceux qui liront, se souviendront… Avec une infinie tendresse, pour nos jours partagés. Nous étions jeunes, beaux, flamboyant, heureux et nous ne le savions pas !
PS/ J’ai eu Christian, au bout du fil, le Christian à la « Rase »! On a bien ri!…
Rendez vous est pris avec Jenny, enfin, pour petit tour au Luxembourg, le 4 octobre 2008… Quarante ans après le fameux mois de mai ! Compter en dizaines : je ne m’y ferai jamais…
Anne Marie WEILER
Une terrasse à Chantilly après le Potager des Princes … 2007 ?